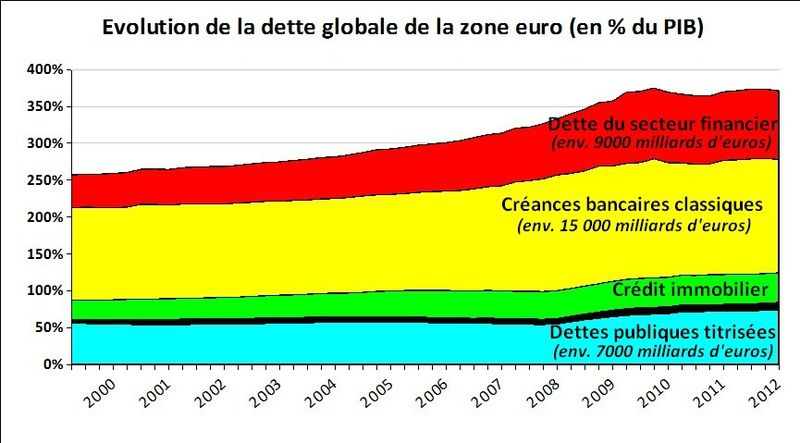Un spectre hante l'Europe : le spectre de la compétitivité. Depuis que la crise étend ses effets sur notre continent, les entreprises s'inquiètent de voir le « grand marché européen » qu'on leur avait tant promis se transformer peu à peu en un immense champ de bataille hyper-concurrentiel. Cette Europe qui avait été conçue pour être un espace d'expansion du capitalisme s'est soudain transformée en système récessif.
Les entreprises ne se battent plus pour gagner des parts de marché. Elles se battent pour leur survie. Depuis 2007, les marges des entreprises françaises ont connu un recul historique, atteignent, en 2011, leur plus bas niveau depuis 1985. La situation est encore plus grave dans l'industrie manufacturière où l'on constate un véritable effondrement. En seulement trois ans de crise, le taux de marge est passé de 28,3 % en 2007 à 23,8 % en 2010. Plus de 300 000 emplois industriels ont disparu pendant cette période.
On ne peut pas comprendre l'actuelle hystérie des gouvernements européens pour la mise en œuvre de plans de compétitivité et de baisse des coûts salariaux si l'on ne perçoit pas cette réalité. L'influence du lobby patronal est à la mesure de la gravité de la situation dans ses entreprises. Renault et Peugeot perdent bataille après bataille face à Wolkswagen. Au même moment, au sud, la crise immobilière qui sévit de l'autre côté des Pyrénées pousse les entreprises du bâtiment à chercher meilleure fortune sur nos terres. Pour survivre, elles cassent les prix et fragilisent un secteur immobilier déjà en situation difficile. Dans tous les secteurs, de toutes parts, l'intensité de la concurrence, poussée par l'effondrement de la demande, réduit les marges des entreprises européennes. Celle-ci n'ont plus seulement à faire face à la concurrence asiatique ; elles se font la guerre entre elles, et c'est une lutte à mort.
L'EUROPE DU SUD EN PREMIÈRE LIGNE
Les gouvernements sont paralysés à l'idée de perdre cette guerre et ils sont prêts à toutes les compromissions pour aider leurs entreprises à repousser les invasions économiques. Ils affûtent des plans de compétitivité comme naguère on préparait des stratégies de conquête. L'année 2012 fût particulièrement riche en la matière, en particulier chez les nouveaux dirigeants issus de la crise. En Italie, Mario Monti engagea ses réformes dès le début de l'année 2012. Il commença par s'attaquer aux retraites avec une réforme particulièrement brutale qui réussit à la fois à rallonger la durée de cotisation (de 40 à 42 ans), à reculer l'âge minimal de départ à la retraite (66 ans en 2018) et à réduire le montant des pensions. Au printemps, le gouvernement italien s'attaqua à la réforme du marché du travail. L'objectif, clairement affiché, était de faciliter les licenciements des entreprises en échange d'une indemnisation et d'une sécurisation sociale des salariés. La fameuse « flexi-sécurité ». Les aides directes aux entreprises ne furent pas écartées : réduction des cotisations sociales pour certains emplois, aide à l'investissement des entreprises, instauration d'un crédit d'impôt pour les dépenses de recherche ou d'économie d'énergie. Tout cela fut financé en ponctionnant le pouvoir d'achat des ménages, au nom de l'effort de la guerre.
Installé aux manettes de l'Espagne le 20 décembre dernier, Mariano Rajoy ne manqua pas non plus l'occasion de muscler la compétitivité économique de ses entreprises. En dehors des mesures d'austérité qui touchèrent particulièrement les fonctionnaires et les classes moyennes, le gouvernement espagnol s'est attelé, dès le mois de février, à faire passer une réforme du marché du travail encore plus drastique, puisque non seulement elle visait, comme sa cousine italienne, à faciliter les licenciements, mais elle permettait aussi aux employeurs d'imposer des baisses de salaire ou de redéfinir à leur guise la fonction, les horaires et le lieu de travail de leurs salariés. Les contrats de travail sont ainsi devenus amendables, à la discrétion du patronat. Au passage, le gouvernement espagnol en profita pour transformer la hiérarchie du droit social en faisant prévaloir les accords d'entreprise sur les conventions de branche. Enfin, à l'inverse du cas italien, ce démantèlement accéléré du droit du travail ne s'est pas accompagné de mesures sociales compensatoires. Au contraire, la réforme entérina une baisse des indemnités légales de licenciement qui passèrent de 45 jours de salaires par année d'ancienneté à 33 jours, voire 20 jours si l'entreprise peut justifier de trois mois consécutifs de pertes. C'est ainsi que le gouvernement espagnol s'engagea lui aussi dans une véritable politique de dumping social.
En Grèce et au Portugal les mesures de baisse des coûts salariaux et d'affaiblissement du droit social sont plus anciennes. Mais il faut dire qu'en matière de flexibilité, le Portugal faisait figure de pionnier. C'est en effet en 1978 que le gouvernement portugais instaura le système des « recibos verde » (reçus verts). Imaginés à l'origine pour faciliter la rémunération des professions libérales, le système a l'avantage pour l'employeur de n'imposer aucune cotisation patronale ; c'est à l'employé que revient l'obligation de cotiser à un organisme de protection sociale (quand ses finances le lui permettent). Ce dernier est d'ailleurs davantage un prestataire qu'un employé. C'est toute l'ambiguïté sur laquelle repose ce système qui est aujourd'hui massivement utilisé à la place du contrat de travail. Considéré comme exerçant une profession libérale, le travailleur ne bénéficie de pratiquement aucun droit social. Il peut être licencié du jour au lendemain, sans prévis et sans indemnités ; il n'a le droit à aucune assurance chômage, ni congé payé. Plus de 20 % des actifs portugais sont aujourd'hui concernés par ce régime, dont 140 000 qui travaillent pour la fonction publique.
Malgré l'extrême précarité du droit social local, le gouvernement portugais ne s'est pas exempté d'une réforme du marché du travail à destination des salariés qui ont la chance de bénéficier d'un vrai contrat. Avec la crise, et sous pression de la Troïka (l'alliance de la BCE, la Commission européenne et du FMI), le gouvernement portugais lança en janvier 2012 une réforme pour « assouplir » les règles en matière de temps de travail et de recours aux licenciements. Particularité locale, cette réforme supprima également quatre jours fériés.
Enfin, que dire des réformes en Grèce ? Elles surpassent tout ce qu'on peut imaginer en matière de démantèlement du droit du travail. La bataille engagée pour améliorer la compétitivité des entreprises grecques a entraîné le pays dans une véritable spirale de réformes toutes plus brutales les unes que les autres. Ainsi en 2010, la Troika imposa pas moins de quatre réformes du marché du travail. Chacune apporta sa contribution en matière de flexibilisation des horaires de travail, de facilitation des licenciements ou de diminution les salaires, en particulier du salaire minimal. Comme ces mesures échouèrent à redresser l'économie grecque qui s'enfonça encore davantage dans la crise, deux nouvelles lois furent adoptées en 2011, en échange de rares sursis financiers de la Troïka, et avec la même logique et le même succès. Enfin, en février 2012, la Grèce instaura une septième réforme du marché du travail qui imposa la diminution du salaire minimum de 22 % (32 % pour les moins de 25 ans) et qui suspendit toute augmentation automatique des salaires prévus par les accords de branche. Malgré ces mesures, il semblerait que les autorités européennes et le FMI considèrent que l'effort grec est encore insuffisant. Dans un récent rapport, la Commission exige d'assouplir davantage la durée hebdomadaire du travail pour permettre aux salariés de travailler six jours par semaine. Il n'est donc pas exclu qu'une huitième réforme vienne balayer ce qui reste de droit social dans ce pays.
COMPÉTITIVITÉ CONTRE COOPÉRATION : UN RENVERSEMENT HISTORIQUE
Inutile de poursuivre plus avant la description de ces politiques. Mais constatons que la brutalité avec laquelle celles-ci se sont imposées dans le sud de l'Europe ne peut que susciter, à moyen terme, une action défensive de la part des pays plus au nord. Ainsi, en dehors du cas français, des réformes pour la compétitivité ou la réduction des droits sociaux sont à l'ordre du jour en Belgique, en Allemagne et au Royaume-Uni, pour ne prendre que les cas de nos plus proches voisins. Au nom de la lutte pour l'emploi et pour la croissance, l'ensemble des pays européens est en train de s'engager dans ce que les économistes appellent des « politiques de l'offre », et qu'ils enrobent du doux nom de « compétitivité ».
Mais à bien y réfléchir, ce mot même de compétitivité cache une formidable régression intellectuelle. Recyclage conceptuel du monde de l'entreprise, il renvoie à l'idée de compétition. Or, être compétitif, ce n'est pas être efficace, c'est être meilleur. De l'efficacité à la compétitivité, on passe donc de l'absolu au relatif. Si l'on peut comprendre que pour une entreprise individuelle, la performance implique souvent un gain dans le cadre d'une lutte concurrentielle, du point de vue d'une Nation, l'efficacité nécessiterait plutôt un équilibre, ou à tout le moins l'achèvement d'un collectif organisé de manière harmonieuse.
Car s'il est une leçon à retenir de la crise de 2009, c'est que les économies sont bien davantage interdépendantes qu'elles ne sont concurrentes. Alors que les déboires d'Airbus dans la conception de l'A350 ont assez logiquement bénéficié à Boeing et à ses commandes de 787, la crise des subprimes aux États-Unis n'a en rien bénéficié à l'Europe. Ce qu'un pays perd en croissance économique ne se fait pas au bénéfice d'un autre pays, bien au contraire ! Voilà pourquoi la logique des États, la logique macroéconomique, n'a rien à voir avec la logique des entreprises. Au niveau macroéconomique, la notion de compétitivité relève donc davantage d'un argument fallacieux au service d'intérêts particuliers que d'une analyse économique sérieuse.
Pour illustrer cette idée, qu'il nous soit permis d'évoquer l'histoire récente. Au sortir d'une effroyable guerre mondiale, les « pères fondateurs » de la construction européenne avait bien conscience qu'en matière économique la coopération est bien plus efficace que la compétition. La mise en place de la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA), puis du Marché commun, avaient pour but de prévenir toute pratique mercantiliste entre les puissances du vieux continent. Au début des années 1970, dans un monde économique devenu plus instable par la fin du système monétaire hérité de Bretton Wood, les Européens prirent soin d'empêcher entre eux toute guerre monétaire en créant des outils pour stabiliser les taux de change de leurs monnaies. La création du marché unique, puis de l'euro, vinrent parachever l'édifice dans lequel la coopération économique aurait dû pouvoir s'installer.
Or, depuis le milieu des années 90, nous assistons à un renversement total de cette logique coopérative. Profitant du fait que les restrictions commerciales et les dévaluations monétaires étaient devenues impossibles, des économies du nord de l'Europe se sont mises à pratiquer une politique de « dévaluation » fiscale et sociale. Le premier pays à s'engager dans cette voie fut l'Irlande, dont la stratégie de développement fut fondée sur une pratique systématique du dumping fiscal, avec un impôt sur le revenu des sociétés de 12,5 %... contre plus de 30 % en moyenne en Europe. De nombreuses firmes multinationales profitèrent de l'aubaine pour faire de l'Irlande leur base productive à partir de laquelle elles pouvaient exporter dans tout le continent, sans droit de douane et sans risque.
Dans les années 2000, d'autres pays s'engagèrent sur des voies comparables. La Suède avait réformé en profondeur son modèle social dès la fin des années 90. En Allemagne, les lois « Hartz », mises en place entre 2003 et 2005 (il y en eut quatre), ont contribué à comprimer les salaires allemands qui ont significativement décroché par rapport à ceux du reste des pays européens. Ainsi, entre 1995 et 2012, alors que la productivité du travail en Allemagne a évolué au même rythme que dans le reste de l'Europe, l'écart relatif entre les salaires allemands et ceux du reste de l'Europe s'est creusé de plus de dix points. Cette politique, que l'on peut qualifier de « dévaluation salariale », a permis à l'Allemagne d'engranger des excédents commerciaux records... au détriment de ses partenaires européens, en particulier de la France.

LES SALARIÉS, CHAIR A CANON DE LA POLITIQUE EUROPÉENNE
Comme le rappelle l'Organisation internationale du travail, la stratégie allemande ne fut pas simplement néfaste pour les salariés allemands. En renforçant les exportations allemandes, elle fut également l'une des causes des gigantesques déséquilibres commerciaux qui firent le lit de la crise européenne. Or, l'explosion de la crise a paradoxalement précipité la généralisation de ces politiques, et cela avec l'aide active de la Commission européenne et de la BCE.
Pourtant, à aucun moment, les responsables européens qui mettent aujourd'hui en œuvre des politiques de compétitivité en totale contradiction avec la logique coopérative qu'ils promouvaient jadis ne s'interrogent sur le sens économique de ces mesures. Car si pour une petite économie individuelle une telle politique peut éventuellement fonctionner en permettant à ce pays de gagner des parts de marché sur ces concurrents, à l'échelle du continent en entier personne ne peut croire qu'il soit possible de généraliser les excédents commerciaux intra-européens. Tout ce que l'Espagne pourra gagner avec la relance de ses exportations sera nécessairement pris sur ses partenaires commerciaux, dont l'immense majorité se situe en Europe. La logique qui nous est proposée est donc proprement suicidaire : elle consiste à appauvrir systématiquement les salariés européens pour que chaque pays tente de récupérer une part plus importante d'un gâteau dont la taille ne cesse de se réduire.
Car c'est bien là le drame de la situation actuelle : poussée jusqu'à l'absurde, la logique de la compétitivité n'aboutit qu'à la disparition de la prospérité générale, sans créer le moindre emploi supplémentaire, et participe à l'effondrement de la demande des ménages et à l'intensification de la concurrence. L'Europe est en train de réinventer le mercantilisme le plus obtus ; celui qui confond la logique marchande avec la logique économique, et la balance commerciale avec la prospérité. Aveuglé par l'idéologie, elle conduit une guerre commerciale contre elle-même.
Nous sommes en 1914 et nous envoyons nos salariés dans une boucherie absurde, à la conquête de victoires qui n'existent pas.
------------------------------